Todd dissipe au passage un malentendu largement partagé par une dissidence française qui s’imagine que la « multipolarité » qui se met en place sera compatible avec la « souveraineté » d’un pays européen comme la France. La multipolarité est un ordre mondial dont les acteurs principaux seront de grands ensembles civilisationnels régionaux. La France n’en fait pas partie, pas plus qu’aucune autre nation européenne. L’Europe, qui se veut une multipolarité à elle toute seule, peut-elle devenir un pôle civilisationnel dans la multipolarité globale ?
Samuel Huntington et le retour des civilisations

Les États-nations, tels qu’on les conçoit aujourd’hui, sont une invention européenne imposée comme modèle au reste du monde au XIXe siècle, parfois à grands coups de crayons tracés à la règle sur des cartes, au mépris des identités et des rivalités ethniques. Ce découpage du monde en États-nations n’a pas effacé d’autres réalités, par exemple, le fait que certaines puissances comme la Russie ou la Chine sont des États multinationaux et non des nations, même si elles possèdent leur carte d’identité de nation aux Nations Unies.
La thèse selon laquelle les États-nations vont perdre leur rôle central dans la géopolitique mondiale est défendue par Samuel Huntington dans Le Choc des Civilisations, paru en 1996 et traduit dans le monde entier. C’est un livre excellent, et même indispensable. Sa mauvaise réputation vient en partie de son titre et de son exploitation par les néoconservateurs. Notons d’abord que l’article publié par Huntington dans Foreign Affairs en 1993, dont le livre est une version augmentée, portait le titre “The Clash of Civilizations?” avec un point d’interrogation.
Par ailleurs, le titre complet du livre est, en anglais, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Mais on remarque que, d’une édition à l’autre, la seconde partie du titre est devenue de plus en plus petite. Dans la traduction française, elle a totalement disparue. Cela n’est pas anodin, car Order s’oppose évidemment à Clash, et il est évident, à la lecture du livre, que Huntington ne prône pas le « choc » des civilisations, mais un nouvel « ordre mondial » entre les civilisations.
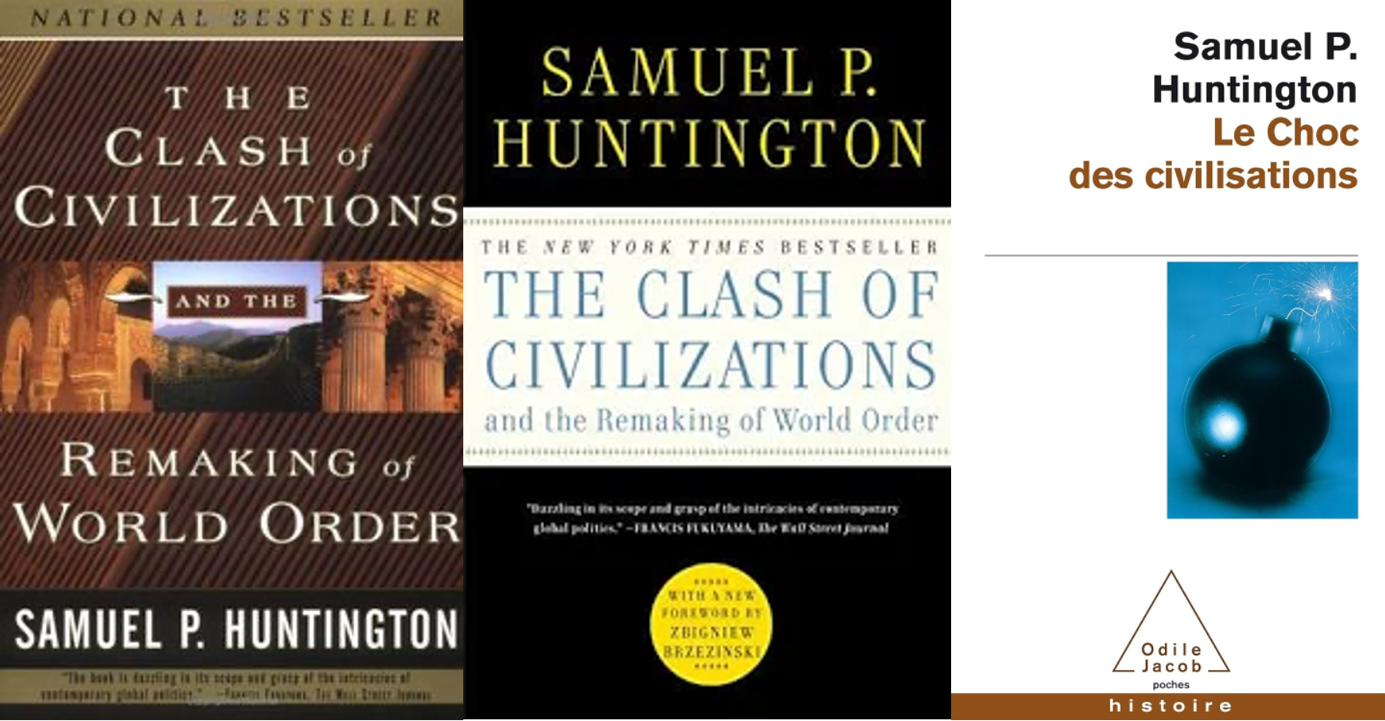
Quand le titre d’un livre aussi médiatisé et applaudi dit le contraire du livre, le message du titre a plus d’impact que celui du livre. Étant donné la manière dont le livre de Huntington a été présenté, après le 11-Septembre 2001, comme une prédiction de ce qui venait d’arriver, on doit conclure que le travail de Huntington a été exploité par les néoconservateurs à leurs fins belliqueuses. Pour comprendre cela, je renvoie à la section « anatomie de l’État profond » de mon article « 11 Septembre 2001 : la théorie du complot piraté », dans lequel j’analyse la façon dont les crypto-sionistes néoconservateurs ont détourné la géostratégie impériale traditionnelle des États-Unis prônée par le Council on Foreign Relations, dont le théoricien le mieux connu était Zbigniew Brzezinski, très proche de Huntington. Bien entendu, Brzezinski et Huntington portent une grande part de responsabilité dans l’usage qui a été fait de leurs travaux, car ils ont protesté un peu tard contre leur détournement. Mais les considérer comme des néoconservateurs, comme je le vois souvent faire en France, est un contresens. Ni l’un ni l’autre n’ont été signataires du PNAC (contrairement à Francis Fukuyama, auteur de La Fin de l’Histoire), et tous deux ont fermement critiqué la Guerre en Irak en 2003.
J’insiste : on ne peut pas comprendre la politique étrangère et militaire états-unienne des deux dernières décennies si l’on ne prend pas en compte ce détournement de la géostratégie impériale traditionnelle par les néoconservateurs. La grande ruse des néoconservateurs a été de se draper dans l’impérialisme « civilisateur » américain pour pousser les États-Unis à détruire des États arabes ennemis d’Israël. Leur succès le plus spectaculaire est d’avoir obtenu de Bush Junior ce que son père, qui les appelait the crazies, leur avait refusé en 1991 : l’invasion de l’Irak et le renversement de Saddam Hussein. Bush père s’en était tenu au mandat du Conseil de Sécurité de l’ONU en chassant Saddam du Koweit, et justifia son refus d’envahir l’Irak par la volonté de bâtir un « nouvel ordre mondial » basé sur le droit international (discours du 11 septembre 1990 devant le Congrès). Et aucun président américain n’a appliqué autant de pression sur Israël au nom des résolutions de l’ONU, avec son Secrétaire d’État James Baker.
Je suggère donc au passage que nous arrêtions de réagir de manière pavlovienne à l’expression banale et neutre de « nouvel ordre mondial » comme si elle était le mot de passe que s’étaient donnés tous les malfrats de la planète pour leur projet commun de dictature mondiale—auquel cas il faudrait ranger Poutine et Xi Jinping dans cette catégorie, puisqu’eux aussi emploient ce langage.
Le nouvel ordre mondial qu’annonce Huntington est à peu près le même
que celui que prône Poutine : la multipolarité, soit un monde organisé
en ères civilisationnelles, chacune étant centrée sur un « État phare » (core state en version originale) qui assure la sécurité régionale. « Le monde, prédit Huntington, trouvera un ordre sur la base des civilisations, ou bien il n’en trouvera pas2 » ; « un
ordre mondial organisé sur la base de civilisations apparaît. Des
sociétés qui partagent des affinités culturelles coopèrent les unes avec
les autres ; […] les pays se regroupent autour des États phares de leur
civilisation. » Dans cette nouvelle configuration, prévient Huntington,
« les Occidentaux doivent admettre que leur civilisation est unique
mais pas universelle et s’unir pour lui redonner vigueur contre les
défis posés par les sociétés non occidentales. Nous éviterons une guerre
généralisée entre civilisations si, dans le monde entier, les chefs
politiques admettent que la politique globale est devenue
multicivilisationnelle et coopèrent à préserver cet état de fait3. »
Certes, Huntington affirme que, « pour préserver la civilisation occidentale, en dépit du déclin de la puissance de l’Occident, il est de l’intérêt des États-Unis et des pays européens » d’intégrer dans l’OTAN la Slovénie et la Croatie, d’encourager l’ « occidentalisation » de l’Amérique latine, « d’empêcher le Japon de s’écarter de l’Ouest et de se rapprocher de la Chine », et « de maintenir la supériorité technologique et militaire de l’Occident sur les autres civilisations ». Mais il recommande aussi :
- « de considérer la Russie comme l’État phare du monde orthodoxe et comme une puissance régionale essentielle, ayant de légitimes intérêts dans la sécurité de ses frontières sud ; »
- « – et, enfin et surtout, d’admettre que toute intervention de l’Occident dans les affaires des autres civilisations est probablement la plus dangereuse cause d’instabilité et de conflit généralisé dans un monde aux civilisations multiples. »
Huntington passe en revue tous les grands ensembles et leurs rapports entre eux, et tente de prédire leurs évolutions possibles, qui devraient aller dans le sens du regroupement des États-nations sous l’effet des champs d’attraction de grands États-phares, qu’on peut appeler tout simplement des puissances impériales. La Chine est sans doute la mieux préparée à cette évolution. Depuis les années 1990, elle s’est donnée pour but de « devenir le champion de la culture chinoise, l’État phare jouant le rôle d’aimant vers lequel se tournent toutes les autres communautés chinoises et retrouver sa position historique, perdue au XIXe siècle, de puissance hégémonique en Extrême-Orient4. » Économiquement, l’ascendance régionale chinoise est déjà acquise.
L’économie de l’Extrême-Orient est de plus en plus centrée autour de la Chine et dominée par elle. Les Chinois de Hong Kong, de Taiwan et de Singapour ont fourni la plus grande partie des capitaux qui ont permis la croissance sur le continent dans les années quatre-vingt-dix. Au début des années quatre-vingt-dix, les Chinois représentaient aux Philippines 1% de la population mais contrôlaient 35 % du chiffre d’affaires des entreprises locales. En Indonésie, au milieu des années quatre-vingt, les Chinois représentaient 2 à 3 % de la population, mais possédaient environ 70 % des capitaux privés locaux. Dix-sept des vingt-cinq plus grandes entreprises étaient contrôlées par des Chinois, et un conglomérat chinois contribuait à lui seul pour 5 % au PNB. Au début des années quatre-vingt-dix, les Chinois constituaient 10 % de la population de Thaïlande, mais possédaient neuf des dix plus grands groupes et contribuaient pour 50 % au PNB. Les Chinois représentent un tiers de la population de Malaisie, mais dominent presque totalement l’économie. Hors du Japon et de la Corée, l’économie de l’Extrême-Orient est fondamentalement une économie chinoise5.
L’une des grandes forces de la Chine, c’est l’exceptionnelle solidarité ethnique entre les Chinois de Chine et les Chinois de la diaspora, installés parfois depuis plusieurs générations. Pour les Chinois, « le sang prime sur l’eau » (blood is thicker than water) ; « la confiance et les engagements dépendent des contacts personnels, pas de contrats, de lois ou d’autres documents légaux. » Ce fameux « réseau de bambou » (bamboo network) donne aux Chinois de l’étranger un énorme avantage pour commercer avec la Chine. L’homme d’État singapourien Lee Kuan Yew a dit :
Nous sommes d’ethnie chinoise. […] Nous partageons certaines caractéristiques en vertu de notre culture et de nos ancêtres communs. […] Les gens éprouvent une empathie naturelle pour ceux qui partagent leurs attributs physiques. Cette conscience de l’existence d’une proximité est renforcée quand ils ont une base linguistique et culturelle commune. Cela facilite la confiance et les relations, qui sont le fondement de tous les rapports d’affaires6.
Je souligne que cette puissante solidarité ethnique est encouragée par le confucianisme et par la vénération des ancêtres. Cette dernière est si fondamentale en Chine que l’Église catholique a renoncé à la combattre et en 1939 l’a exceptionnellement déclarée licite pour les catholiques chinois. Je renvoie à mon article « éloge du culte des ancêtres » pour ce sujet qui devrait être au cœur de toute réflexion sur les civilisations.
L’avenir du monde islamique est incertain, mais l’évolution prévisible est que l’Iran et la Turquie vont rester des pôles civilisationnels forts, tandis que l’Égypte et l’Arabie saoudite vont se disputer la direction d’un panarabisme qui a échoué jusqu’à présent (par la volonté d’Israël, mais Huntington ne le dit pas), et que l’Asie centrale turcophone cherche sa place entre la Russie et la Turquie. Le monde islamique illustre mieux que tout autre les limites de l’État-nation.
La structure de la loyauté politique entre Arabes et entre musulmans a en général été l’opposé de celle qui prévaut dans l’Occident moderne. Pour ce dernier, l’État-nation est le parangon de la loyauté politique. Des loyautés plus restreintes lui sont subordonnées et sont subsumées dans la loyauté vis-à-vis de l’État-nation. Les groupes qui transcendent les États-nations — communautés linguistiques ou religieuses, ou civilisations — requièrent une loyauté et un engagement moins intenses. Le long du continuum qui va des entités les plus étroites aux plus larges, les loyautés occidentales atteignent ainsi un sommet au milieu, la courbe d’intensité de la loyauté formant en quelque sorte un U renversé. Dans le monde islamique, la structure de la loyauté a été presque l’inverse. L’islam connaît un creux au milieu de la hiérarchie de ses loyautés.
Les “deux structures fondamentales, originales et durables”, comme le notait Ira Lapidus, étaient la famille, le clan et la tribu d’une part, et “les unités formées par la culture, la religion et l’empire à plus grande échelle” de l’autre7.
Dans l’islam, « la tribu et la Oumma ont été les principaux
foyers de loyauté et d’engagement. L’État-nation est bien moins
important. Dans le monde arabe, les États existants rencontrent des
problèmes de légitimité parce qu’ils sont pour la plupart les produits
arbitraires, voire capricieux, de l’impérialisme occidental, et leurs
frontières ne coïncident souvent même pas avec celles des groupes
ethniques, comme c’est le cas pour les Berbères et les Kurdes8. » [a]
La géopolitique et l’âme des civilisations
Les grands principes géopolitiques sur lesquels s’appuie Huntington sont hérités des textes fondateurs de la philosophie des civilisations, comme ceux de l’Allemand Oswald Spengler ou de l’Anglais Arnold Toynbee9. [b]
La géopolitique met l’accent sur l’importance de la géographie dans la constitution des ensembles politiques et de leurs rapports de force. Le Britannique Halford MacKinder, auteur en 1904 d’un article séminal sur « le Pivot géographique de l’histoire10 », était géographe et n’a jamais prétendu être autre chose. La géographie détermine à ses yeux le projet géopolitique britannique, qui est basé sur le contrôle des mers, tout comme pour l’Allemand Karl Haushofer (1869-1946), également géographe, elle imposait à l’Allemagne le projet d’étendre son espace vital (lebensraum) à l’est11.
Les géopoliticiens ont souvent une vision « organique » des civilisations, par opposition à une vision strictement déterministe ou « mécanique » de l’histoire comme celle que propose le marxisme. MacKinder conçoit « l’histoire comme une partie de la vie de l’organisme mondial ». Cette conception organique, souvent implicite, est très marquée chez le russe Nicolas Danilevski, qui était biologiste de formation et a peut-être influencé Spengler.
La métaphore organique a cependant ses limites, lorsque par exemple elle prend à la lettre les notions d’enfance, de maturité, de vieillesse et de mort des civilisations (on attend toujours la vieillesse de la civilisation chinoise). Elle sombre dans une forme de biologisme lorsqu’elle assimile civilisation et ethnicité, comme ce fut le cas dans le mouvement volkisch allemand. Pour surmonter cette limite, il faut voir les civilisations sont des organismes intelligents, c’est-à-dire mus non pas par des pulsions, mais par des idées. Pour Spengler, par exemple, l’Occident est la civilisation faustienne, dont l’idée motrice est le dépassement de toutes les limites. Spengler parle ici de l’Occident postchrétien ; jusqu’à la fin du Moyen Âge, l’Occident, c’était la chrétienté romaine.
Les Idées-forces qui animent les civilisations ont leur propre
logique. Par exemple, comme j’ai essayé de le montrer dans le quatrième
chapitre de mon livre La Malédiction papale,
l’injonction donnée à chaque individu de se sauver, et la négation du
prolongement des solidarités familiales dans l’au-delà, ont mené
logiquement à cette disposition d’esprit qui distingue très nettement
l’Occident postchrétien, et que l’on nomme l’ « individualisme »12.
De la même manière, l’individualisme et son corolaire l’égalitarisme,
menés à leur terme, conduisent à la négation de l’identité de genre.
Comme l’écrit Damien Viguier dans un petit livre lumineux, « la
suppression dans l’espace des droits de tradition européenne, de toute
conséquence juridique à la distinction entre les deux sexes, devait
nécessairement conduire au mariage et à la parentalité homosexuel13. »
Dans un article intitulé « le singe devenu dieu », j’ai expliqué que le darwinisme, qui est notre catéchisme laïc, mène logiquement au transhumanisme, comme le démontrent d’ailleurs le darwinien transhumaniste israélien Yuval Noah Harari et le succès de ses livres Sapiens et Homo Deus : si c’est le hasard (les accidents génétiques) et la sélection naturelle qui nous ont faits, alors faisons mieux grâce à la technologie et prenons en main l’évolution de notre espèce.
Les idées-forces d’une civilisation descendent des élites cognitives vers les masses, et non l’inverse. Elles peuvent être interrompues dans leur course par des changements brutaux de paradigme, comme le sont les révolutions. À noter aussi qu’elles peuvent être en partie suscitée, ou tout au moins stimulée, par « rivalité anti-mimétique » avec celles d’une autre civilisation : c’est ce qu’on observe aujourd’hui dans la polarisation des valeurs défendues respectivement par la Russie et l’Occident. C’est grâce à l’Occident qui a atteint le stade terminal de son idée faustienne (l’abolition des limites anthropologiques) que la Russie post-soviétique a pu se réinventer autour de la défense des valeurs traditionnelles.
Croire en l’influence prépondérante des idées sur la destinée des civilisations, c’est être idéaliste au sens philosophique du terme. Et l’idéalisme a pour autre nom le platonisme, entendu comme la théorie sur l’existence et l’influence réelle des Idées. Au sens large, énonce le théologien russe Pavel Florenski (1882-1937), le platonisme doit être compris « non pas comme un système défini et immuable de concepts et de jugements, mais comme un certain type d’aspiration, comme un doigt divin pointant de la terre vers le ciel, des choses d’en bas vers les choses d’en haut14. » Alexandre Douguine, inspirée par une riche tradition orthodoxe, affirme dans Le Platonisme philosophique (éditions Ars Magna, 2023) que la géopolitique, comme la politique, n’a de sens que dans une vision platonicienne, car chaque civilisation a son Idée motrice, qui résulte de facteurs géographiques, historiques et ethniques, mais peut-être aussi de forces spirituelles mystérieuses, sans oublier l’action décisive des « grands hommes », qui impriment leur âme sur celle de leurs peuples (le théoricien de l’importance des héros et grands hommes dans l’histoire est l’Écossais Thomas Carlyle, mort en 1881).
Si les civilisations ont une âme, sont-elles soumises à des « lois spirituelles » ? Y a-t-il, dans ce qu’Oswald Spengler appelait « la nécessité organique du destin15 », une forme de karma collectif ? Autrement dit, une civilisation paye-t-elle, à terme, les conséquences de ses actes, ou bien est-elle mue uniquement par l’idée qu’elle se fait d’elle-même et de son destin ? Dans une perspective idéaliste ou platonique, les croyances agissent dans notre vie, mais la vérité agit d’un niveau supérieur (l’action directe de la vérité sur l’esprit humain est ce qu’on nomme l’intuition). Une civilisation, au même titre qu’une personne, file du mauvais coton lorsque ses croyances sont contraires à la réalité, lorsqu’elle se ment à elle-même, ou refuse de se regarder dans le miroir que lui tendent les autres civilisations.
Quel avenir pour l’Europe ?
Dans un entretien donné à la revue Éléments (avril-mai 2023), Christopher Coker, l’auteur de The Rise of the Civilizational State, explique : « Les Européens ne peuvent pas devenir un État civilisationnel. Les lignes de fracture qui traversent l’Europe […] ont réglé la question. » Sans véritable unité et indépendance politiques, l’Europe ne constitue pas un « pôle » dans la multipolarité. Dans La Malédiction papale, je démontre que l’état de désunion politique et de décomposition civilisationnelle de l’Europe est le résultat d’un problème de croissance durant l’enfance de l’Europe, c’est-à-dire le Moyen Âge. L’Europe médiévale a désiré ardemment se doter d’une unité politique impériale, comme l’a montré Robert Folz dans L’Idée d’Empire en Occident du Ve au XIVe siècle (1953). Les souverains, les intellectuels, les peuples aspiraient à cet idéal, synonyme à leurs yeux non de tyrannie mais de paix et de prospérité.
Le processus organique de l’unification politique européenne était bien engagé sous la dynastie des Otton (936-1024), mais il fut contrarié sous la dynastie des Saliens (1024-1125) par l’ambition politique concurrente des papes, qui se dotent d’un État, vassalisent d’autres États, s’arrogent le droit de mobiliser leur classe militaire, et cherchent à faire de l’empereur nominal leur lieutenant. La dernière tentative d’unifier l’Europe autour du Saint Empire Romain échoue sous la dynastie des Hohenstaufen (1125-1250), dont l’histoire grandiose et tragique se termine par l’extermination de la descendance de Frédéric II par l’homme de main du pape, Charles d’Anjou, frère de Louis IX. À partir du XIVe siècle, les jeux sont faits : l’Europe s’est fragmentée en une mosaïque d’États nationaux jaloux de leur indépendance, dont les identités nationales vont se cristalliser dans des guerres à répétitions, qui sont autant de « guerres civiles européennes ». Ainsi, écrit Georges Minois dans La Guerre de Cent Ans. Naissance de deux nations :
La guerre de Cent Ans est plus qu’une guerre, c’est une mutation de civilisation, qui marque le passage de la chrétienté féodale à l’Europe des nations, à travers la prise de conscience de l’identité nationale de la France et de l’Angleterre16.
Mais la supra-monarchie pontificale, qui semblait alors triompher au XIIIe siècle, échoue elle aussi avec la nationalisation de la papauté par Philippe le Bel, puis la Réforme protestante. L’échec des deux projets (impérial et papal) laisse l’Europe en état de désunion et de guerre perpétuelle chronique, engagée dans une compétition effrénée pour le perfectionnement des techniques de guerre qui lui permettra de conquérir le monde, mais la consumera en définitive.
« Les nations, c’est la guerre », disaient les pionniers de la construction européenne dans la seconde moitié du XXe siècle. Comment leur donner tort ? Bertrand de Jouvenel a bien analysé l’évolution de la guerre dans son essai mémorable, Du Pouvoir, écrit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale : tandis qu’au XIIe siècle, la guerre était encore « toute petite », parce que les États ne disposaient ni de l’obligation militaire ni du droit d’imposer, elle devint au fil des siècles la grande affaire de ces mêmes États :
si nous ordonnons en série chronologique les guerres qui ont déchiré notre monde occidental pendant près d’un millénaire, il nous apparaît de façon saisissante que de l’une à l’autre le coefficient de participation de la société au conflit a été constamment croissant, et que notre Guerre Totale n’est que l’aboutissement d’une progression incessante vers ce terme logique, d’un progrès ininterrompu de la guerre17.
Dans l’espoir de pacifier cette Europe qui a la guerre dans le sang, Emmanuel Kant émettait en 1795 le projet d’une « ligue de nations républicaines » dans un manifeste titré Vers la Paix perpétuelle, considéré comme fondateur de la « théorie des relations internationales ». L’idée motrice est dorénavant l’Europe républicaine, fondée sur des principes universaux comme les droits de l’homme et le droit à l’auto-détermination des peuples. C’est cette Europe kantienne qui fut finalement réalisée au XXe siècle. On connaît le résultat. Précisément parce qu’elle se fonde sur des principes qu’elle proclame comme universaux, cette Europe se donne pour identité une absence d’identité. Elle se veut une Europe mondiale, sans frontière idéologique, ce qui l’a conduit inéluctablement, par la logique interne de son idée fondatrice, à renier ses propres frontières ethniques et géographiques.
La raison profonde, organique, pour laquelle l’Europe moderne est un échec, c’est qu’elle n’est pas enracinée dans l’histoire de l’Europe. On peut même dire que la construction européenne des années 1950 s’est faite sur les ruines d’une Allemagne punie pour avoir encore cru en son destin d’État phare de l’Europe. Cette Europe est un corps sans tête et donc sans âme, qui a vidé les peuples européens de toute « conscience civilisationnelle » européenne.
L’Europe réelle se ressent si peu comme un organisme unifié que, chaque fois que l’URSS lui arracha un morceau de son flanc oriental (1956 et 1968), les Européens de l’Ouest ne ressentirent aucune douleur. Tel est le drame évoqué par l’écrivain tchèque Milan Kundera dans son essai de 1983, « un Occident kidnappé », où il rappelle aux Européens de l’Ouest l’importance culturelle de la Bohême.
La disparition du foyer culturel centre-européen fut certainement un des plus grands événements du siècle pour toute la civilisation occidentale. […] comment est-il possible qu’il soit resté inaperçu et innommé ? / Ma réponse est simple : l’Europe n’a pas remarqué la disparition de son grand foyer culturel, parce que l’Europe ne ressent plus son unité comme unité culturelle18.
Mais quelle unité culturelle aurait pu sauver l’Europe centrale, sans unité politique ? Il ne peut y avoir de volonté politique sans unité politique.
Dans un petit livre fort intéressant, Si l’Europe s’éveille. Réflexion sur le programme d’une puissance mondiale à la fin de l’ère de son absence politique (Mille et une nuits, 2003), le philosophe allemand Peter Sloterdijk s’interroge sur l’avenir de l’Europe comme pôle civilisationnel, capable d’imposer sa propre identité et sa propre volonté entre les États-Unis et la Russie. Il parvient lui aussi à la conclusion que le mythe fondateur et moteur de l’Europe a été, depuis Charlemagne, la translatio imperii, soit l’héritage impérial romain, déplacé vers le nord depuis les conquêtes arabes, incarné par l’Empire romain germanique, mais détruit par l’acharnement des papes. Sloterdijk a écrit cet essai en 1994, estimant que la dislocation du bloc communiste était l’occasion pour l’Europe de se réinventer. Malheureusement, il n’a pas émis d’idée précise sur la manière dont cela aurait pu se faire, et force est de constater que l’Europe est plus que jamais inexistante comme puissance politique indépendante. Par l’intermédiaire de l’OTAN, elle est tombée entièrement sous la vassalité de l’Empire américain.
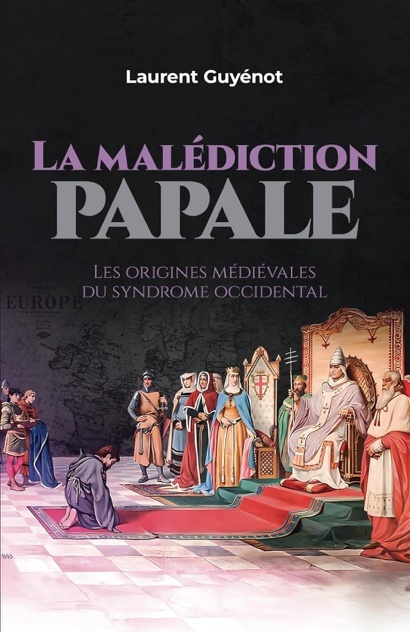 Comme je l’écris dans mon nouveau livre La Malédiction papale,
l’idéaliste peut toujours rêver de souveraineté nationale, mais le
réaliste sait que, pour se libérer de la domination américaine (qui est
en fait, de plus en plus, une domination israélienne), l’Europe n’a pas
mieux à faire que de rétablir de bonnes relations avec la puissance
impériale russe, porteuse de valeurs civilisationnelles saines. Le
réaliste ne renonce pas à l’Europe, mais il fait le pari que l’entente
avec la Russie et son projet de multipolarité sera plus favorable à la
renaissance d’une civilisation et d’une souveraineté européennes que la
domination états-unienne. Enfin, le réaliste admet que l’Allemagne, et
non la France, reste le leader naturel de la civilisation européenne,
comme elle l’a toujours été. L’Europe ne pourra renaître en tant que
civilisation que si l’Allemagne trouve la force de résister au racket de
Washington et forge une alliance durable avec la Russie.
Comme je l’écris dans mon nouveau livre La Malédiction papale,
l’idéaliste peut toujours rêver de souveraineté nationale, mais le
réaliste sait que, pour se libérer de la domination américaine (qui est
en fait, de plus en plus, une domination israélienne), l’Europe n’a pas
mieux à faire que de rétablir de bonnes relations avec la puissance
impériale russe, porteuse de valeurs civilisationnelles saines. Le
réaliste ne renonce pas à l’Europe, mais il fait le pari que l’entente
avec la Russie et son projet de multipolarité sera plus favorable à la
renaissance d’une civilisation et d’une souveraineté européennes que la
domination états-unienne. Enfin, le réaliste admet que l’Allemagne, et
non la France, reste le leader naturel de la civilisation européenne,
comme elle l’a toujours été. L’Europe ne pourra renaître en tant que
civilisation que si l’Allemagne trouve la force de résister au racket de
Washington et forge une alliance durable avec la Russie.
Notes
- Emmanuel Todd, La Défaite de l’Occident, Gallimard, 2024, p. 24-25.
- Samuel P. Huntington, Le Choc des civilisations, Odile Jacob, 1997, p. 170.
- Ibid., p. 17.
- Ibid., p. 184.
- Ibid., p. 185.
- Ibid., p. 186.
- Ibid., p. 191.
- Ibid., p. 192.
- Huntington mentionne, p. 37, les « historiens, sociologies et anthropologues » suivants : Max Weber, Émile Durkheim, Oswald Spengler, Pitirim Sorokin, Arnold Toynbee, Alfred Weber, Alfred L. Kroeber, Philip Bagby, Carroll Quigley, Rushton Coulborn, Christopher Dawson, Shmuel N. Eisenstadt, Fernand Braudel, William H. McNeill, Adda Bozeman, Immanuel Wallerstein, et Felipe Fernandez-Armesto.
- Halford MacKinder, “The Geographical Pivot of History,” The Geographical Journal, avril 1904, sur www.jstor.org.
- Les travaux de Haushofer eurent une grande influence sur Hitler, par l’intermédiaire notamment de Rudolf Hess, mais lui-même tomba en disgrâce dans l’Allemagne hitlérienne, et son fils fut exécuté par les Nazi. Tenu pour partiellement responsable du nazisme après la guerre, il se suicida avec sa femme en 1946.
- Cette thèse n’est pas nouvelle. L’anthropologue Louis Dumont en a donné une version dans son essai sur « La genèse chrétienne de l’individualisme moderne », originellement publié sous le titre « De l’individu-hors-du-monde à l’individu-dans-le-monde », et inclus dans son livre Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne, Seuil, 1983, p. 35-81.
- Damien Viguier, De la famille clanique au couple parental homosexuel, KontreKulture, 2015, p. 14.
- Pavel Florenski, The Meaning of Idealism: The Metaphysics of Genus & Countenance, translated and edited by Boris Jakim, Sematron Press, 2020, p. 5.
- Oswald Spengler, Le Déclin de l’Occident. Esquisse d’une morphologie de l’histoire universelle, Gallimard, 1976, p. 19.
- Georges Minois, La Guerre de Cent Ans. Naissance de deux nations, Tempus/Perrin, 2010, p. 12.
- Bertrand de Jouvenel, Du Pouvoir. Histoire de sa croissance (1972), Pluriel/Hachette, 1998, p. 21-25.
- Milan Kundera, « Un occident kidnappé, ou la tragédie de l’Europe centrale », Le Débat, 1983, n°27, p. 3-23.
Par Laurent Guyénot − Mai 2024
-------------------------------------------------La 'asabiyya est un concept clé de l'œuvre d'Ibn Khaldûn, à la base de l'écriture de cette autre histoire du monde. La 'asabiyya est une force sociale, un esprit de corps, une dynamique de solidarité guerrière. Elle est le propre des marges, des tribus qui l'exercent ponctuellement au détriment des sédentaires. Ces derniers sont plus riches, individualisés mais domestiqués par l'État, garant de leur sécurité en échange de leur productivité. Pour Ibn Khaldûn, c'est la'asabiyya des tribus arabes qui leur a permis au VIIe siècle de briser les prospères empires perses et byzantins, pourtant infiniment plus peuplés. Car structurellement, un empire ne peut être que faible. Il ne dure que s'il désarme ses sujets, les cantonne à des activités productrices qu'il peut taxer (agriculture, commerce...). Ce faisant, il perd la force guerrière qui a permis sa création, et il est souvent emporté en trois générations. Ainsi le premier empire musulman, celui des Omeyaddes, dure un siècle (650-750). Pour perdurer, un empire doit pacifier son élite combattante, il devient vulnérable. Son ancienne 'asabiyya n'est plus. Il doit donc chercher d'autres 'asabiyya à ses marges, des tribus mercenaires qui renonceront à l'agresser moyennant rémunération. Rome soudoie les Barbares qui se pressent à ses frontières, leur accorde sa citoyenneté pour qu'ils la protègent de la convoitise des hordes suivantes.
Aujourd'hui, les "barbares" de l'Empire judéo-occidental sont désignés par "proxies" ( Frères Musulmans (ISIS/EI, FIS en Algérie, islamo-terroristes en Afrique Noire), Kurdes, Israël, Ukronazis, Ouïghours, Tchétchènes, etc.)
[b] Dans L'Occident
"civilisé " vs l’Orient "barbare" : qu'en est-il au juste ?, nous avions écrit :
Arnold Toynbee définit une «civilisation» comme «un champ intelligible d’études historiques». Ainsi l’Angleterre a une culture propre, avec sa langue, ses rituels sportifs et sa gastronomie particulière, mais elle ne constitue pas pour autant une civilisation parce que son Histoire est incompréhensible si on ne la relie pas à celle de ses voisins européens. Toynbee n’en admet pas moins des affinités et des passerelles plus ou moins intenses entre les civilisations elles-mêmes. Ainsi considère-t-il que les trois civilisations (occidentale, orthodoxe et islamique) sont issues de ce qu’il appelle le rameau syro-hellénique (pensée grecque et monothéisme oriental).
« La classification de Toynbee, très historique et faisant une large place aux grandes religions, …. fournit finalement une morphologie et une typologie méthodologique du phénomène des civilisations, et conduit à une rare vision de synthèse planétaire de la métamorphose des sociétés auxquelles beaucoup d'historiens rendent encore hommage. » — Roland Breton, Géographie des civilisations, Paris, P.U.F., coll. Que sais-je. 1991.
….
Bien avant Auguste Comte ou Jules Michelet, on pourrait faire remonter la première ébauche des sciences sociales à l'œuvre d'Ibn Khaldoun. Né à Tunis en 1332, mort au Caire en 1406, Ibn Khaldoun est le plus connu des historiens arabes. Contemporain de Froissart, de Chaucer et de Pétrarque, il exerça diverses fonctions administratives au Maghreb (l'Occident, en arabe) et en Égypte où il occupa la haute charge de Grand Cadi (juge suprême). Le "Kitâb al-‘Ibar" ou « Livre des Exemples » est une histoire universelle monumentale à laquelle il travailla près de trente ans, et dont l’objet est la civilisation et la société humaine. Ce livre fait de lui non seulement un historien, mais, cinq siècles avant Auguste Comte, l’inventeur de la sociologie.
De ce penseur médiéval, Arnold Toynbee dit qu’il a « conçu et formulé une philosophie de l’Histoire qui est sans doute le plus grand travail qui ait jamais été créé par aucun esprit dans aucun temps et dans aucun pays. »
Dans la "Muqadimma", les Prolégomènes, Ibn Khaldoun est conscient que sa démarche profondément novatrice rompt résolument avec l’interprétation religieuse de l’histoire qui prévalait jusque-là : « Les discours dans lesquels nous allons traiter de cette matière formeront une science nouvelle […] C’est une science ʺsui generisʺ car elle a d’abord un objet spécial : la civilisation et la société humaine, puis elle traite de plusieurs questions qui servent à expliquer successivement les faits qui se rattachent à l’essence même de la société. Tel est le caractère de toutes les sciences, tant celles qui s’appuient sur l’autorité que celles qui sont fondées sur la raison. ».
Tout au long de son œuvre, ce premier théoricien de l’histoire des civilisations souligne la discipline à laquelle doivent s’astreindre ceux qui exercent le métier d’historien : « L’examen et la vérification des faits, l’investigation attentive des causes qui les ont produits, la connaissance profonde de la manière dont les événements se sont passés et dont ils ont pris naissance. »
Ibn Khaldoun a pour champ d’étude uniquement la partie du monde qu’il connaît, pour y avoir séjourné : Andalousie, Maghreb et Moyen Orient. C’est dans ce cadre restreint qu’il élabore sa théorie cyclique des civilisations rurales ou bédouines (‘umrân badawi) et urbaines (‘umrân hadari). Pour lui, les civilisations sont portées par des dynamiques tribales qui fondent dynasties et empires. Ibn Khaldoun, témoin de la chute du monde musulman à son époque, a introduit, bien avant Leontiev, la notion de cycles. Il a expliqué les conditions de naissance, d’évolution et de ruine des empires. Pour lui, les empires naissent et disparaissent selon un mécanisme primitif : la violence. La violence coloniale a entraîné la chute des empires coloniaux français et britannique. La violence pratiquée par l’Empire américano-sioniste depuis la seconde guerre mondiale (Palestine, Corée, Viet Nam, Afghanistan, Irak, Libye, Syrie, Ukraine, etc.) devrait, selon cette théorie khaldounienne, annoncer la chute prochaine de cet empire.
En introduisant le cycle de vie, Ibn Khaldoun fut le premier penseur à avoir l’idée que les catastrophes dans l’Histoire ouvrent la voie à de nouvelles “histoires”. D’autres penseurs ont une vision linéaire de l’Histoire.
VOIR AUSSI :
- Un holocauste de proportions bibliques
par L. Guyénot
- Laurent
Guyénot: La peur provoquée par les Juifs et par leur "Dieu de la
terreur"
- L.
Guyénot. La lentille biblique et la lumière nietzschéenne
- La
Russie, entre panslavisme et byzantinisme
- Laurent
Guyénot – Qui a maudit les Kennedy ?
- Laurent
Guyénot sur le génocide biblique de Bibi et l'anniversaire de JFK
- Point
de vue de L. Guyénot concernant l'Ancien Testament
- Pourquoi
faut-il exterminer Amalek ? Petite leçon biblique – Laurent Guyénot
Hannibal Genséric
Hannibal Genséric
Un lien intéressant pour une analyse - grâce au matériel laissé par certains intervenants - de leur caractéristiques psychopathologiques :
RépondreSupprimerhttps://fr.timesofisrael.com/comment-des-trolls-rusent-pour-fausser-ce-que-vous-lisez/
Michel Dakar
Ibn Khaldoun,que j'ai un peu avait analysé ces facteurs de SON TEMPS. Jusqu'au début du 20éme siècle sa méthode était encore valable. Mais......voilà à partir du 1900 une SECTE est entrée brutalement dans l'histoire avec un pouvoir de manipulation et de nuisances diabolique, au point de faire se battre, anéantir, affaiblir SIX EMPIRES EUROPÉENS, en 1918 QUATRE puissances disparurent. Les 2 survivantes étaient gravement atteintes. Bis répétita en 40 . Ibn-Khaldoun ne pouvait pas imaginer qu'arriverait une époque ou une micro fraction de l'humanité de l'ordre de 0.30%, pourrait contrôler de fait 8milliards d'humains et les amener au bord du gouffre. En effet c'est la même SECTE qui en ce moment veut poursuivre avec un acharnement sadique la guerre en Ukraine CAR SON VRAI BUT c'est l'éclatement de la Russie. *Les études sur Ibn Khaldoun en anglais,sont plus fouillées.
RépondreSupprimer